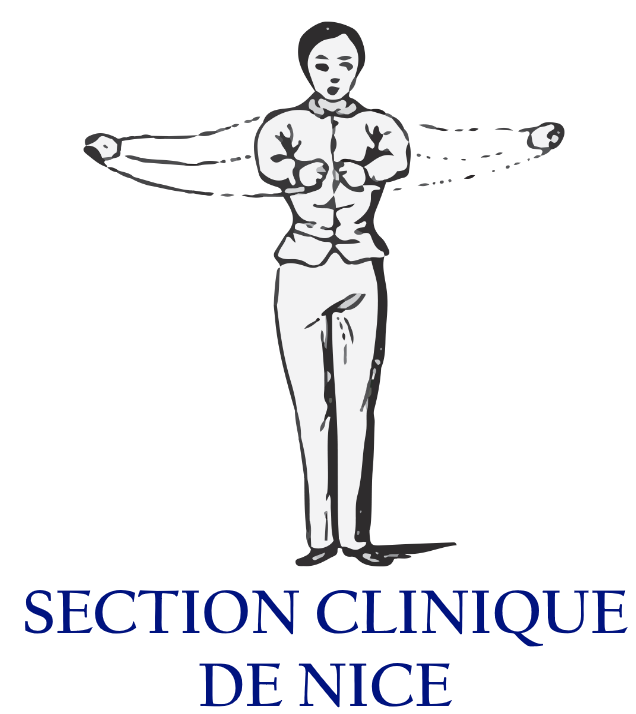Newsletter n°15
2 mai 2023
Trois questions à Aurélie Pfauwadel
Partie 2/3
propos recueillis par Karim Fenichel
@propos : Là où Foucault situe la généalogie de la psychanalyse du côté du religieux et de la pratique de soi, Lacan situe son émergence dans l’histoire de la pensée à partir de la philosophie de Kant et de Sade et de l’évènement de la science moderne. Il propose donc une archéologie scientifique de l’histoire de la psychanalyse. Vous rappelez la proposition de Lacan : si elle n’est pas elle-même une science, la psychanalyse est fille de science. Lacan pose même qu’elle est le rebut de la science. N’est-ce pas déjà une façon de signifier que le discours de la psychanalyse est l’envers du discours du maître, contrairement à ce que prétend Foucault ?
Aurélie Pfauwadel : La question cruciale est de savoir s’il est possible d’opposer aux généalogies foucaldiennes, une histoire de la psychanalyse qui en préserverait la spécificité et la subversion. En effet, il convient de souligner la volonté de gommage de la radicalité de la coupure freudienne chez Foucault.
Ainsi que le relevait Jacques-Alain Miller, dès lors que le « dispositif de sexualité » – dans lequel Foucault inscrit la psychanalyse – se définit par le trait pertinent de « parler de sexe », c’est tout le dispositif de la chair chrétienne et de l’examen de conscience qui s’engouffre dans la recherche archéologique. De là, Foucault est irrésistiblement mené à cette généalogie religieuse et spirituelle de la psychanalyse qu’il esquisse dans L’herméneutique du sujet[1].
Dans ce cours, Foucault exprime son regret que la psychanalyse ne se considère pas elle-même comme une pratique du souci de soi[2]. À l’instar des autres sciences humaines, elle s’inscrit plutôt dans l’histoire du « connais-toi toi-même ». Foucault y indique en effet que certaines formes de savoir qui ne sont pas des sciences – la psychanalyse et le marxisme –, mais qu’il ne convient pas d’assimiler pour autant à des religions, recèlent des éléments qui les apparentent fortement à des formes de spiritualité.
Contrairement à cette irrésistible spirale foucaldienne, Lacan situe quant à lui une véritable discontinuité au moment de l’émergence du discours de la science moderne. Ainsi, les éléments provenant de traditions plus anciennes, les racines innombrables et immémoriales de la psychanalyse doivent être repensés à partir de la coupure de l’âge scientifique.
Mais Lacan ne fait pas seulement de la psychanalyse la « fille » de la science, il lui confère le statut de « rebut » du discours de la science – c’est moins noble ! Il relève qu’elle accueille tout ce qui se trouve rejeté et forclos par le discours de la science : la dimension de la vérité (qu’il distingue du savoir scientifique), la castration ou l’impossible, la jouissance du corps parlant… Ainsi, Lacan fait de la psychanalyse un symptôme de la civilisation moderne et c’est sans aucun doute ce qui en fait l’inexorable contrepoint du discours du maître, traditionnel (« patriarcal ») ou moderne – celui produit par l’alliance de la science au capitalisme.