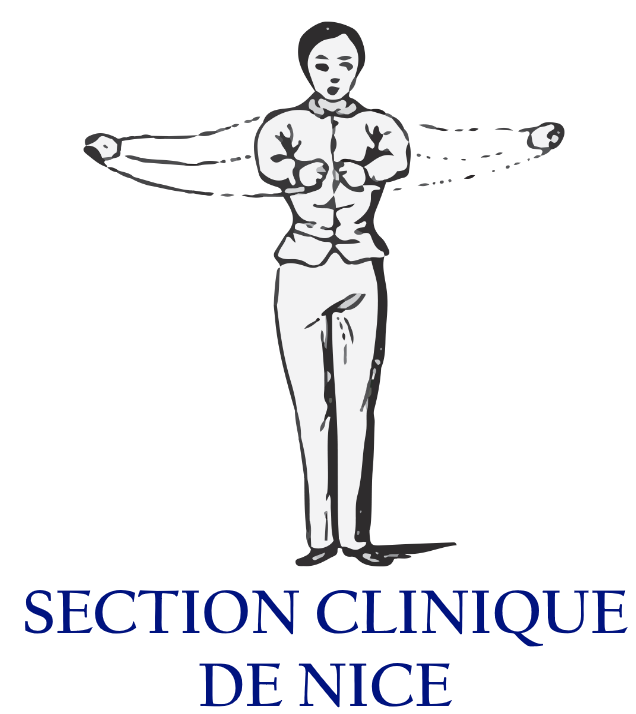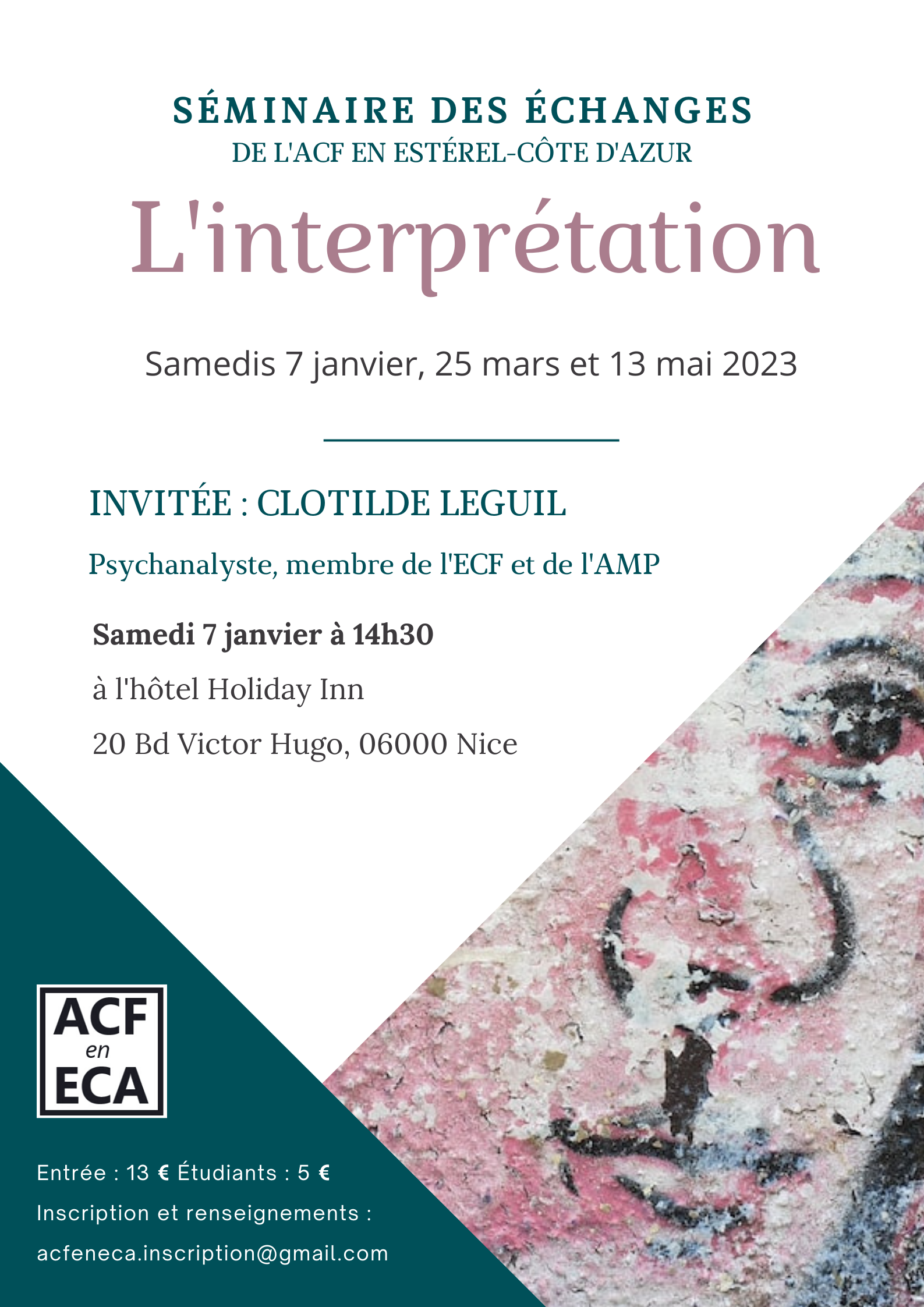Newsletter n°12
13 décembre 2023
L'interprétation
Interview de Clotilde Leguil
Le Séminaire des échanges est l’occasion pour l’ACF en ECA d’un dialogue avec un, ou une analyste d’une autre région. Pour 2023, Clotilde Leguil a répondu favorablement à notre proposition de travailler sur le thème de l’interprétation. Ce seront donc trois conférences où ce thème sera déplié, en suivant les chemins de l’analyse : 7 janvier, 25 mars et 13 mai. En guise d’argument, Clotilde Leguil a accordé un mini entretien pour @propos.
@propos : Chère Clotilde Leguil, vous avez tout de suite accepté cette invitation à travailler sur l’interprétation. Vos travaux sont traversés par un intérêt pour ce thème. Pouvez-vous nous dire en quoi l’interprétation éveille, pour vous, cet intérêt sans cesse renouvelé ?
Clotilde Leguil : Oui, j’ai tout de suite accepté votre invitation car la question de l’interprétation en tant qu’elle introduit à un rapport inédit à la parole me semble cruciale pour la psychanalyse, dans le moment dans lequel nous sommes. La pratique de l’interprétation nous introduit à ce que Lacan appelait « l’obscurantisme propre à la parole[1] ». C’est cette opacité de la parole qui est déniée dans les discours contemporains sur les identités. Cet obscurantisme de notre propre parole, nous ne pouvons le découvrir que grâce à l’interprétation. L’énigme de ce que je dis, surgit dans l’expérience de l’analyse comme expérience de parole. Je découvre que là où je croyais savoir ce que je désirais dire, je ne sais pas ce que je dis. C’est le sens que Lacan donne à la découverte freudienne de l’inconscient. « Ne pas savoir ce que je dis » me permet alors, grâce à l’interprétation, d’accéder à ce qui dans ma parole relève d’un désir méconnu.
@propos : Un cycle de trois conférences est prévu (janvier, mars et mai). Cette façon de scander la progression d’un raisonnement en trois moments est certes classique mais bien opératoire et nous aurons à cœur d’y insuffler l’esprit du renouveau de l’enseignement de Lacan. Pouvez-vous nous dévoiler quelques indices de la progression à venir au long de vos interventions ?
C.L. : Je souhaite parcourir à travers ces trois conférences les chemins de l’analyse, depuis l’expérience de l’énigme de la vérité, jusqu’à celle de l’épreuve du réel. Ma première conférence portera sur « Les obstacles contemporains à l’interprétation ». La seconde conférence portera sur « La présence de l’analyste et l’expérience de l’inconscient ». La troisième conférence portera sur « L’interprétation à la fin de l’analyse, le régime de la lettre, celui du bafouillage ».
J’indique que les textes de Jacques-Alain Miller « La théorie du partenaire[2] » et « L’interprétation à l’envers[3] » me serviront de balises, ainsi que l’article d’Éric Laurent, paru en 2021 sur « L’interprétation : de l’écoute à l’écrit[4] ».
@propos : Donner à entendre au sujet ce qu’il a dit, ou même lui donner la possibilité de prendre ses distances avec ce qu’il a dit, n’est pas toujours possible. Quelles sont selon vous les conditions de possibilité pour qu’il y ait interprétation ?
C.L. : Ces conditions de possibilité sont de l’ordre d’un consentement à ne pas savoir. Ce consentement ne peut se produire que si advient le miracle du transfert, que le psychanalyste porte la parole et non l’éteigne. Lacan l’énonce dans le « Discours de Rome » : « Il s’agit en effet non pas de passage à la conscience, mais de passage à la parole, n’en déplaise à ceux qui s’obstinent à lui rester bouchés, et il faut que la parole soit entendue par quelqu’un là où elle ne pouvait même être lue par personne : message dont le chiffre est perdu ou le destinataire mort.[5] »
@propos : Considérons les effets de signification d’une interprétation comme incalculables, ajoutons à cela que la temporalité entre ce temps deux (celui des effets), et le temps un (de l’interprétation) est imprévisible, allant du présent immédiat au futur lointain. À l’envers de l’évaluable, l’interprétation analytique s’enseigne-t-elle ?
C.L. : L’interprétation analytique n’est pas de l’ordre d’une tekhnè, mais d’une création. Jacques-Alain Miller a parlé dans son cours sur « L’être et l’Un[6] », du statut créationniste de l’interprétation. L’analyste interprète non pas depuis une méthode, mais depuis une écoute singulière. Plus l’analyste aura lui-même été analysé, plus son écoute sera en prise avec les résonances de la langue de l’analysant. C’est de s’être défait d’un certain rapport au sens, qui permet à l’analyste d’entendre ce que l’analysant n’entend pas de sa propre parole, son désir énigmatique, sa jouissance opaque. L’interprétation est une pratique qui place en son cœur la tuché, contingence de ce qui surgit au sein d’une parole qui ne sait plus ce qu’elle dit.
[1] Lacan J., « Dissolution », Aux confins du séminaire, Paris, Navarin, 2021, p. 67.
[2] Miller J.-A., « La théorie du partenaire », Quarto, no 77, juillet 2002, p. 4-35.
[3] Miller J.-A., « L’interprétation à l’envers », La Cause freudienne, no 32, février 1996, p. 13.
[4] Laurent É., « L’interprétation : de l’écoute à l’écrit », La Cause du désir, no 108, juillet 2021, p. 58-65.
[5] Lacan J., « Discours de Rome », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 140.
[6] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. L’Être et l’Un » (2010-2011), enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, inédit.