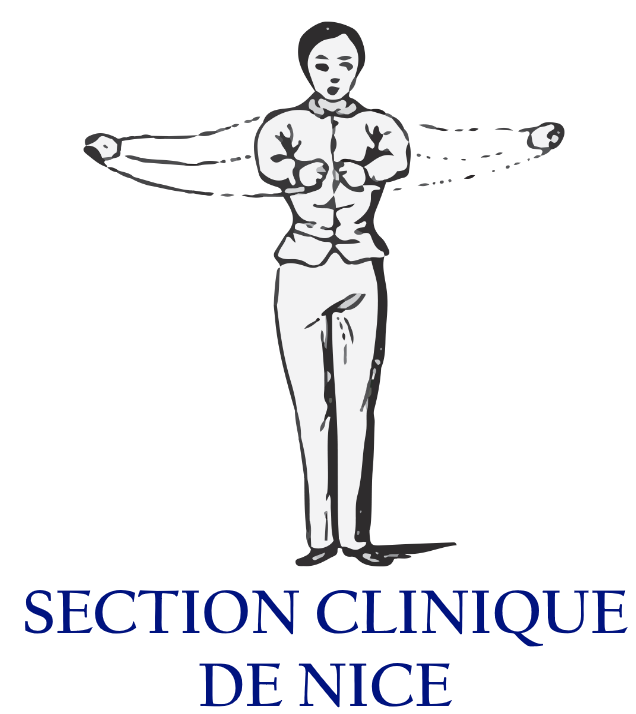SECTION CLINIQUE DE NICE
SESSION 2023 - 2024
Symptôme, fantasme...
Les appareils de la jouissance
Argument
Freud dans sa rencontre avec les hystériques s’est intéressé aux symptômes qui défiaient la médecine. Avec ses Conférences d’introduction à la psychanalyse[1], il fait entendre la complexité de la constitution du symptôme dans l’inconscient : message caché, dont le sens peut se déchiffrer par la parole, qui insiste, et se répète –, car il véhicule une satisfaction paradoxale qui est source de conflits pour le sujet. Freud fera du conflit psychique inconscient la cause de la formation des symptômes. Dans l’expérience analytique, le symptôme s’interprète.
Si le symptôme fait souffrir et que l’on s’en plaint, le fantasme suscite parfois la honte et demeure voilé car il s’inscrit dans l’imaginaire et renvoie à la sexualité qui, si elle n’est plus porteuse de tabous comme au temps de Freud, reste pour le sujet un point de butée faute de pouvoir être symbolisée.
Symptôme et fantasme forment ainsi un couple contrasté – À la polysémie du symptôme s’oppose la fixité du fantasme mais ils ont en commun d’être des nécessités structurales.
Lacan, fidèle à la lecture freudienne du symptôme, l’aborde d’abord sur son versant signifiant et le considère comme une modalité inconsciente de jouissance. Tout au long de son enseignement, il va l’interroger et en préciser sa fonction en allant au-delà de Freud. À partir de l’effet de la parole sur le symptôme, l’analyse détermine la quête d’une vérité, qui révèlera sa dimension de fiction face à un réel impossible à supporter. Aujourd’hui, dans cette optique, une psychanalyse poussée jusqu’à un certain point rend possible de faire avec les restes symptomatiques – ce que Lacan appelle le sinthome – qui autrement continueraient à parasiter l’existence du sujet et son lien social, altérant, sans relâche, ses capacités à aimer, désirer et jouir.
Avec le Séminaire XX, Lacan aborde la réalité par l’intermédiaire des « appareils de la jouissance » et opère ainsi un virage majeur qui fonde son dernier enseignement sur des disjonctions qui touchent ce qui allait de pair auparavant : le signifiant et le signifié, la jouissance et l’Autre, l’homme et la femme. Cette nouvelle clinique introduit des signifiants qui mettent l’accent sur la jouissance – lalangue, l’apparole, le parlêtre, et le sinthome. Nous en découvrirons les conséquences pour l’expérience analytique d’aujourd’hui puisqu’elle ne s’inscrit pas dans le registre du Nom-du-Père mais de la jouissance Une.
Chantal Bonneau
[1] Freud S., Conférences d’introduction à la psychanalyse, Paris, collection Folio Essais, Gallimard, 2010.

Symptôme, fantasme...
Les appareils de la jouissance